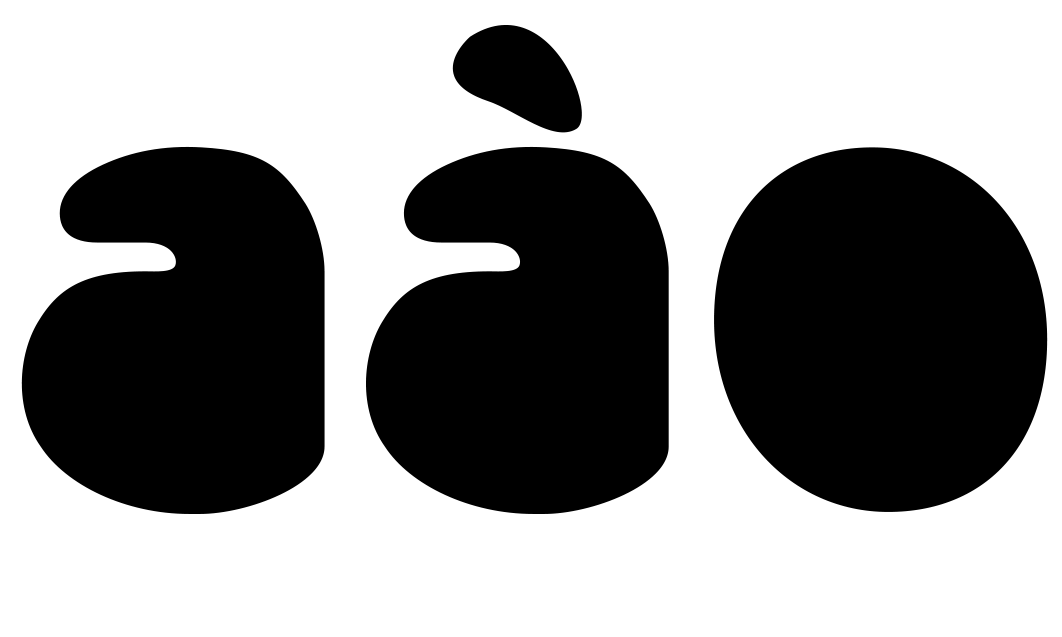Dolorès Marat
« Je me rappelle la première fois que j’ai vu des photos de Dolorès Marat et que je l’ai rencontrée, ce devait être en 1990 à l’occasion de la publication de son premier livre, Éclipse. Parmi les images qu’elle m’a montrées, il y avait celle de la petite robe noire jetée sur un lit. J’ai tout de suite compris que c’était un autoportrait. Cette image a été souvent reproduite. Chaque fois que je la revois, elle me fait penser à Edith Piaf. Il y a entre ces deux femmes comme un faisceau d’affinités : même sensibilité à vif, même volonté indomptable d’aller jusqu’au bout de ce qu’on a choisi, même énergie qui vient des trippes et met sous tension un corps menu et d’apparence si fragile. Dolorès Marat le dit elle-même : “Chez moi, on n’avait pas de livres, ni de télévision. On n’avait rien. Ça m’est venu du ventre : je voulais être photographe pour raconter des histoires, pas avec les mots de la bouche, mais avec ceux des yeux”.
L’univers qu’elle nous restitue est constitué principalement de lieux de passage anonymes : la rue, le métro, le cinéma, la fête foraine, le parking, l’aéroport. Des êtres murés dans leur solitude y croisent leurs trajectoires, suspendent leur dérive nocturne, l’espace d’un instant, la durée précisément d’une pose photographique un peu longue parce que la lumière est rare et aussi pour donner au corps le temps de bouger. Assez longtemps pour qu’ils regardent passer leur vie.
Cette ville, on la situe difficilement. Elle est générique. Comme le sont toutes ces images : le flou des visages, la tendance à réduire les personnages à des silhouettes, sans caractère individuel facilitent l’identification et l’empathie. A Paris, à New York ou ailleurs, les marginaux, les sans abri, ou laissés pour compte qu’elle croise au hasard de ses déambulations ne constituent jamais des sujets sociaux. Ils sont présents comme éléments d’un univers où dominent un sentiment d’abandon, d’exclusion mais pas d’abord comme victimes d’un ordre social qu’il importerait de remettre en question. L’engagement de Dolorès Marat est d’un autre ordre, son Internationale est celle des écorchés de la vie. Le signe qu’elle envoie n’est pas de revendication : juste un signe de reconnaissance, à tous les sens du terme.
(…) On l’aura compris, son œuvre est bien un autoportrait masqué. Ce thème obsessionnel de la solitude, de l’évasion vers un ailleurs intime, elle ne l’a pas choisi : il s’est imposé a elle dès le début. Chez elle, à Avignon où elle vit maintenant, les murs sont tapissés de ses photographies ; elle en est entourée comme s’il s’agissait de miroirs qui lui renverraient son image démultipliée. Prendre une photographie, même la plus triste, est pour elle un moment de bonheur, de libération : la découverte d’une adéquation aussi juste que possible entre ce qu’elle perçoit du monde à un instant donné et son univers intérieur. Aussi faut-il imaginer Dolorès Marat heureuse derrière son objectif. Elle se souvient de la joie inexplicable qu’elle éprouvait, enfant, lorsqu’il avait neigé. Son rêve aujourd’hui : photographier le Palais des Papes sous la neige. Parce que ce serait beau. On dirait que… »
J.-C. Fleury (extraits)